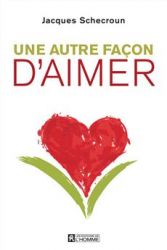
Certes, de toutes celles qui ont coulé, il en est beaucoup qui, hélas, étaient inévitables parce que justifiées par des circonstances douloureuses, voire quelquefois insoutenables. Mais combien d’autres ne l’étaient pas ou ne l’étaient pas tant que cela ? Combien de conflits, en effet, aurions-nous pu nous éviter ? Combien de malentendus, de déchirures, de blessures aurions- nous pu nous épargner ? De combien de nos misères, de combien de nos peines aurions-nous pu nous dispenser ? Et fallait-il vrai- ment, faut-il vraiment, comme le chantait Édith Piaf, « tant et tant de larmes pour avoir le droit d’aimer » ?
Ces questions, pour ce qui me concerne, je ne me les suis pas toujours posées et lorsque je revois le jeune homme que j’étais vers la fin des années 1960, rien ne laissait prévoir qu’un jour viendrait où elles m’interpelleraient. Rien ne semblait me prédestiner à écrire cet ouvrage. Ainsi, du temps où e décrochais le diplôme qui devait me permettre de devenir avocat, j’étais convaincu, aveuglé par ma juvénile ambition, que ce sésame m’ouvrirait définitivement les portes de la réussite à tous points de vue, et même si la philosophie avait quelque peu enthousiasmé mes dix-sept ans qui, alors, n’étaient pas si loin, j’étais à des années-lumière de me poser des questions existentielles.
Mes premiers chagrins d’amour, chagrins tout à la fois incommensurables sur le moment et bien éphémères au bout du compte, semblaient, paradoxalement, donner plus encore d’attrait aux flèches de Cupidon et, tout en aspirant au grand amour, il est évident que je n’envisageais guère une façon d’aimer qui ne soit pas gorgée de larmes. D’ailleurs, lorsqu’un jour j’étais tombé sur les Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke où il écrivait que les jeunes gens ne savent pas aimer, je me souviens de m’être fort présomptueusement moqué ! Non, mais ! pour qui se prenait-il, celui-là ? C’était évident que, moi, je savais aimer !
Sans doute a-t-il fallu, au cours des années qui ont suivi et jusqu’autour de la trentaine, bien des larmes pour me rendre compte que je faisais fausse route, bien des larmes pour n’en plus pouvoir de mes souffrances, bien des larmes pour, disons-le, vaincre mes résistances – qui n’étaient pas des moindres -, bien des larmes pour accepter de reconnaître mon mal de vivre et pour me résoudre à demander de l’aide afin de tenter de m’en guérir.
Je ne me doutais pas, alors, en entreprenant cette démarche qui, dans mon esprit profane, ne devait durer que le temps de quelques séances, que c’était faire le premier pas du plus difficile, mais aussi du plus délicieux de tous les voyages. Je ne soupçon- nais pas que je prenais le chemin d’une autre façon d’aimer, celle- là même dont, sans la nommer ainsi, parlait Rilke, auquel, adolescent, je n’avais rien compris.
Une autre façon d’aimer, « œuvre suprême, disait-il, dont toutes les autres ne sont que les préparations ». Une autre façon d’aimer qui n’avait plus besoin de « tant et tant de larmes ». « Une autre façon de m’aimer moi-même, une autre façon d’aimer, une autre façon d’aimer l’autre, une autre façon d’aimer la vie, une autre façon d’aimer Dieu. Une autre façon d’aimer qui ne dépend de nul autre que de soi ; une autre façon d’aimer qui ne détruit ni ne juge, ni n’envahit ni n’offense, ni n’attend ni ne blesse ; une autre façon d’aimer libérée des mémoires du passé, allégée du fardeau de la peur, dépêtrée des vieilles croyances et déliée des anciens schémas répétitifs ; une autre façon d’aimer qui ne subit pas, qui voit toujours en l’autre un miroir de soi- même et qui rend à chacun la totalité de sa puissance ; une autre façon d’aimer qui s’enrichit de tout ce qui est ; une autre façon d’aimer qui participe de l’idée que nous ne sommes qu’un et qu’il y a assez de tout pour tous ; une autre façon d’aimer qui ne doit rien à personne et qui n’a rien d’autre à faire qu’à être ; une autre façon d’aimer qui a changé ma vie’. »
Ce ne fut pas sans difficulté, car ce n’est pas en claquant des doigts qu’on change des millénaires de façon d’aimer et qu’on crée un barrage à des torrents de larmes coulées. Ce n’est pas juste en disant : « Ah, j’ai compris ! » qu’on renonce à posséder l’autre quand on a toujours considéré qu’il n’y avait rien de plus normal que de s’appartenir mutuellement. Ce n’est pas parce qu’on a suivi un cycle de conférences ou participé à une série de séminaires qu’on fait confiance à l’autre quand on a toujours été jaloux, ni qu’on se fait confiance à soi-même quand on a toujours eu peur de tout ! Ce n’est pas parce qu’on a lu les meilleurs auteurs sur le sujet qu’on cesse de juger et de critiquer quand des générations avant soi ont été des modèles de médisance ! Ce n’est pas non plus juste le fait de consulter qui nous pousse à tourner le dos à la souffrance et aux larmes qui l’accompagnent. Ce fut d’au- tant moins sans difficulté, dans mon cas, qu’à chaque fois qu’une étape semblait avoir été franchie, une épreuve de taille survenait comme pour vérifier que la leçon avait été non seulement bien comprise mais bien intégrée. Ce n’est d’ailleurs toujours pas sans difficulté, et sans doute n’aurai-je pas assez de cette vie pour savoir m’éviter les tourments et pour être totalement et définitivement dans cette autre façon d’aimer. Toujours est-il qu’en 2003, il m’est venu à l’idée, comme pour m’y aider davantage, de créer un grand festival portant ce nom, « Une autre façon d’aimer ». Mon intention était aussi de per- mettre à d’autres de saisir la chance que j’avais eue moi-même, une vingtaine d’années plus tôt, de découvrir cette autre façon d’aimer. J’ai donc invité des auteurs et des conférenciers qui avaient écrit sur ce sujet à venir en parler et c’est ainsi que j’ai eu le privilège d’accueillir, au fil des ans, d’éminentes personnalités venues de tous les coins de France, mais également de Belgique, des États-Unis et du Canada ». Beaucoup sont devenus mes amis et c’est une joie constante d’œuvrer avec eux dans le sens d’une autre façon d’aimer. Ils ont enrichi ma pensée, ouvert de nouvelles pistes de réflexion et, sans trop le savoir, ils m’ont aidé à élaborer davantage encore cette autre façon d’aimer qui n’a nul besoin de « tant et tant de larmes » et qui a donné tout son sens à ma vie.
Le plus fort est qu’en 2011, après quelque quatre décennies d’exercice de la profession d’avocat, j’ai été invité par le barreau de Bruxelles aux côtés, notamment, d’Éric-Emmanuel Schmitt et de Thomas d’Ansembourg, à donner une conférence dans le cadre d’une journée intitulée « Une autre façon d’être avocat », laquelle façon participe aussi, on l’aura compris, d’une autre façon d’aimer, puisqu’il y a été question d’être « déterminé sans être farouche, puissant sans être méchant, audacieux sans être agressif », La boucle, d’une certaine façon, était bouclée. Reste qu’à l’occasion de la dixième édition du festival qui a lieu chaque automne à Cabourg, en Normandie, d’aucuns m’ont suggéré de consacrer un livre à cette autre façon d’aimer qui me tient tant à cœur.
Puisse cette autre façon d’aimer, objet de cet ouvrage, devenir la vôtre et puissent vos larmes n’être plus que de joie.
